Bleus au zizi : abus, pas pris !
École maternie
Un bon tuyau pour les guides pédophiles : à vingt kilomètres de Nantes, il est un coin tranquille où gendarmes et juges laissent un pervers en toute impunité.
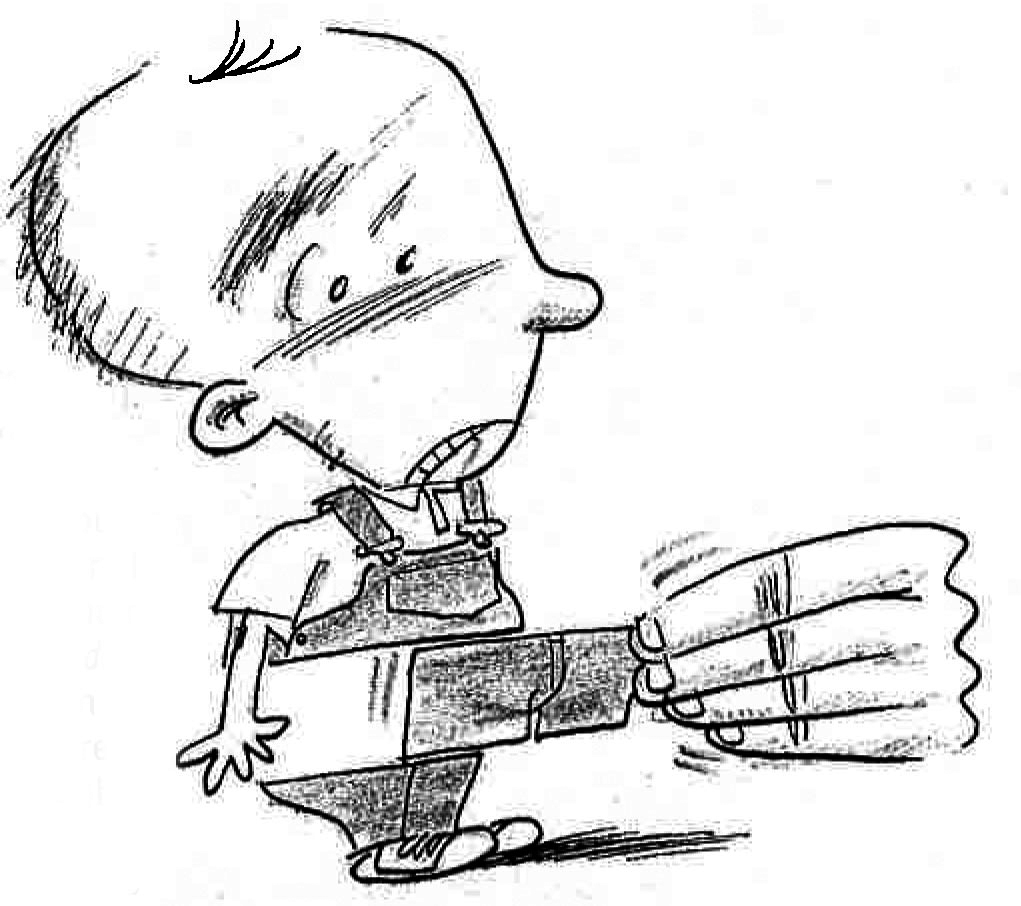
Un juge peut conclure à un non-lieu en matière de pédophilie tout en reconnaissant que l’agression sexuelle a bien eu lieu. Victime sans coupable, donc. Les hématomes sur le bas ventre de l’enfant, les traces sur le sexe ? Indéniables. Un pédophile court toujours, la justice baisse les yeux. Par pudeur, sans doute. « S’il paraît certain que le jeune Antoine a été victime d’une atteinte sexuelle, aucun élément objectif ne permet d’imputer celle-ci à Monsieur B*. ou à toute autre personne entendue ou indentifiée dans le cadre de l’information », écrit le juge d’instruction de Saint-Nazaire Frédéric Digne en ordonnant le non-lieu, confirmé par la cour d’appel de Rennes le 29 octobre. Affaire classée. Circulez.
En novembre 1997, en moyenne section de maternelle d’une école publique d’un village au nord de Nantes, Antoine, quatre ans, revient de l’école avec des traces bleues dans la culotte. Pas facile, pour un loupiot, de porter le choc d’un abus sexuel. Il se tait. Sa mère délie sa parole en expliquant qu’elle même a été victime dans son enfance, tripotée à six ans par un curé. Perturbé, Antoine raconte alors : « On m’a fait mal à mon zizi », il a dû « lécher le zizi » d’un grand qui lui a « fait pipi dans la bouche », il a craché car « c’était pas bon ». Il donne le prénom du seul homme de l’école, le directeur, instit des classes primaires. Enseignant qu’il désigne sur une photo de classe chez sa nourrice. Depuis, la version du petit n’a pas varié. À Nantes, une femme lieutenant de police en civil, formée à ce genre d’entretien délicat, interroge l’enfant, avec tact et douceur, en le faisant dessiner : « C’est le maître dans la classe qui m’a fait mal à mon zizi », lui répète Antoine. Mais, territorialement, l’enquête relève des gendarmes de Blain et de Saint-Nazaire qui prennent le relais. Les parents effarés découvrent de vrais « cow-boys » qui mettent en question leur vie familiale, tout en s’avouant incompétents pour recueillir la déposition d’un gamin de quatre ans. « On va pas noter ce qu’il dit, il a pu être influencé », lâche un de ces subtils pandores. Ce qui rend par ailleurs impossible d’établir d’éventuelles contradictions dans ses paroles de môme. Ses mots sont pourtant crédibles, avec des expressions de son âge, un récit par bribes, un traumatisme psychologique, des gestes obscènes furtifs qui cadrent parfaitement avec les réactions typiques des enfants abusés. La justice écarte d’ailleurs une éventuelle affabulation, mais refuse d’entendre le pédopsychiatre qui, pendant huit mois, a suivi l’enfant perturbé, recueillant des confidences nommant celui qui l’a abusé.
Avertie au lendemain de l’aveu de l’enfant, l’Éducation nationale n’a pas réagi. Contrairement à l’usage de précaution en vigueur depuis les directives de Ségolène Royal, l’inspecteur d’académie ne suspend pas l’enseignant suspecté. En janvier 1998, le cabinet du ministre écrit même aux parents que l’enquête judiciaire « n’a pas abouti à la mise en cause de l’enseignant », alors qu’à cette date, les investigations commencent à peine.
S’étant constitués partie civile, les parents relisent le dossier judiciaire et découvrent qu’une pièce a disparu : le relevé des appels téléphoniques reçus par le directeur de l’école suspecté. Ce qui alimente leurs doutes : risque-t-on d’y lire la trace d’un appel avertissant l’instit avant perquisition à son domicile ? Pour rouvrir le dossier, il faudrait des éléments nouveaux. L’instit assigne en justice les parents d’Antoine, pour un tract qu’ils ont diffusé à 500 exemplaires par fax, mais qui ne le nomme pas. Quant au môme, son innocence en a pris un coup. Un coup de vieux. Il découvre à quatre ans qu’il est coupable. Coupable d’être un enfant.
* Initiale modifiée pour cet article.


